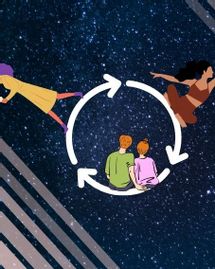Alors que je me vois si belle et si brillante, Dans ce teint dont l'éclat fait naître tant de vœux, L'excès de ma beauté moi-même me tourmente. La Rose, Germain Habert, in La Guirlande de Julie (1641).
Bienvenue dans une période marquée par l’hégémonie de la cour royale dans tous les domaines de la mode. Versailles est "the place to be". Sous l’influence des people, le Grand siècle et du siècle des Lumières (XVIIe et XVIIIe) laisseront une empreinte durable dans l’histoire des arts, du costume, des parfums. On se délecte encore du raffinement des bâtiments qu’ils nous ont légués et de leurs ornements. En revanche, ces deux siècles n’ont pas laissé un souvenir impérissable en termes d’hygiène…
Encore et encore, l’influence italienne
En 1600, notre bon roi Henri IV épouse en secondes noces une "riche héritière" florentine, Marie de Médicis. À cette époque, les monastères de Florence préparent de délicates compositions aux sillages de fleur d’oranger, de myrte ou de rose. Mais Marie découvre auprès de son époux des effluves beaucoup plus rustiques d’ail, d’aisselle virile et de pied "fin" (euphémisme de l’époque pour ne pas dire "puant").
Le Vert Galant, comme on surnomme Henri IV, a la réputation de conter fleurette mais pas celle d’en exhaler le parfum… Comme il n’est pas totalement dénué de coquetterie, il use cependant des parfums prisés à cette époque par la "jet-set" : musc, civette, ambre et épices.
À ces senteurs puissantes, Marie de Médicis préfère la délicatesse des compositions italiennes, à base notamment d’essence de fleur d’oranger, qui ne s’appelle pas encore Néroli (voir plus loin). Marie s’intéresse également aux cosmétiques. Elle est assistée dans ses travaux par sa dame de compagnie Léonora Dori, dite la Galigaï. Mais celle-ci se verra soupçonnée de sorcellerie. À cette époque, des cosmétiques à l’alchimie, il n’y a qu’un pas, et dans les alambics et mortiers de cette sulfureuse intrigante ne se préparent pas que de délicates pommades.
Les fleurs volent au vent
Catherine de Médicis avait déjà apporté "dans ses bagages" son parfumeur, René Le Florentin (Renato Blanco), qui avait créé pour elle "l’eau de reine", puis s’était installé dans une boutique du Pont au Change. Avec sa cousine Marie, la mode du parfum et des gants parfumés à l’italienne n’allait que s’amplifier et, à Paris, les parfumeries se multiplier.
Délaissant les senteurs capiteuses appréciées à la Renaissance, la noblesse française adopte désormais la poudre d’iris, véritable phénomène de mode, l’huile et la pâte d’amande, les essences subtiles de rose, de lis, de violette, de bergamote, de chypre (mousse de chêne) et de fleur d’oranger. Celle-ci est aujourd’hui appelé Néroli en souvenir d'Anne-Marie de la Trémoille d'Orsini, plus connue sous le nom de Princesse de Néroli (ou de Nérola) qui, vers 1680, lança la mode de cette fragrance dans plusieurs cours d’Europe.
Les parfums se conjuguent en diverses préparations : flacons, poudres parfumées, sachets que l’on place entre les "tétins". Ils sont également présents dans la maison sous forme de cassolettes, bougies parfumées, oiselets (pastilles), que l’on fait brûler. Madame de Rambouillet tient un salon des plus influents, dans un décor parfumé d’un rare raffinement qui a sans doute contribué à poser les bases du luxe à la française. Toutes les fleurs y sont mises en valeur et c’est en l’honneur de sa fille Julie que sera composé le fameux recueil La Guirlande de Julie.
La "chimie charitable" de flore
En digne descendante de Catherine Sforza, Marie de Médicis a consigné certaines de ses préparations cosmétiques. Elle laissera quelques manuscrits mais malheureusement aucun recueil. Pourtant, dans la foulée de la Renaissance, les ouvrages de "secrets" sont nombreux au XVIIe siècle.
L’un des plus fameux qui nous soient parvenus est La Chymie charitable et facile, en faveur des dames, de Marie Meurdrac (1666). La sixième partie de ce traité d’alchimie est consacrée pleinement au sujet qui nous intéresse :"l’embellissement du visage et toutes les choses qui peuvent augmenter ou conserver la beauté". S’y ajoutent des soins pour les mains et les cheveux.
On y trouve pêle-mêle des préparations à base de plantes, de corps gras, de matières animales et de minéraux : contre le teint brouillé ou les rides, pour protéger du soleil, rougir les joues et les lèvres, blanchir les dents, teindre les cheveux en blond ou "faire le poil noir", favoriser la repousse des cheveux, etc. Un siècle plus tard, les recettes ne seront guère différentes dans le célèbre ouvrage Toilette de flore, du médecin et auteur prolifique Pierre-Joseph Buc’hoz (1771).
Il fallait bien un pigeon...
Une des recettes les plus surprenantes figurant dans moult recueils des XVIIe et XVIIIe siècles est "l’eau de pigeon", un must de l’époque, sensé donner un teint naturellement beau et frais. Vous voulez la recette ? En voici une des multiples variantes* : "Prendre de l’eau de nénuphar, de melon, de concombre, du jus de limon (citron), une once de chaque; de la bryone, de la chicorée sauvage, des fleurs de lis, de bourrache, de fève, de chaque une poignée; huit pigeons que l’on a hachés; mettez tout cela dans un alambic avec du borax, du camphre, de la mie de pain, du vin blanc et du sucre. Laissez macérer 17-18 jours, puis distillez et recueillez l’eau d’évaporation."
Je vous laisse apprécier, mais est-ce vraiment pire que le collagène récupéré de nos jours sur les carcasses d’animaux d’abattoir ? Je tiens par ailleurs à rassurer les curieuses qui épluchent les recueils historiques : pour préparer la non moins célèbre "eau d’ange", il était inutile de capturer et plumer un chérubin ! Ses multiples variantes ne contenaient que de délicates matières : eau de rose, de fleur d’oranger, de myrte, essences précieuses (benjoin, musc, iris, styrax…). Héritée de la Renaissance, l’eau d’ange fut employée pendant près de 300 ans comme lotion de toilette.
Et voilà le résultat !

Le résultat, on le connaît : après la parenthèse gasconne d’Henri IV, la haute société française va céder à une sophistication croissante. Louis XIII, devenu chauve précocement à la suite d’une maladie, lance "officiellement" la mode de la perruque dès 1620. Les hommes l’adoptent pour cacher des cheveux sales ou devenus défaillants avec l’âge; les femmes lorsque leur chevelure naturelle ne s’accorde plus aux riches étoffes brodées et aux pierreries…
La mode est de se poudrer les cheveux ou la perruque, ce qui donne naissance au commerce florissant des perruquiers, qui disputent aux gantiers le monopole des parfums. Même les plus pauvres cèdent à la tendance et l’on rapporte que de modestes jeunes filles se poudrent les cheveux avec… la poussière qui tombe des charpentes vermoulues !
Le cercle vicieux étant amorcé, la perruque appelle le fard. Emplâtre blanc, lèvres et joues rouges, ce fard est souvent grotesque, "ridicule", pour paraphraser Molière et un célèbre film. Est-ce pour cela qu’il attire les "mouches" ? Initialement, ces petites pièces de taffetas ou de velours enduites d’un emplâtre étaient sensées soulager les maux de dents. Mais on remarqua qu’elle conférait un certain charme à ceux qui les portaient. Dès la fin du XVIIe siècle et durant le XVIIIe, les "mouches" devinrent un accessoire de coquetterie indispensable et on leur accorda même valeur de message, selon l’endroit où elles étaient placées. Hommes et femmes pouvaient en arborer jusqu’à 15 et le message devenait alors difficile à déchiffrer !
Et l’hygiène dans tout ça ?
Dès le règne de Louis XIII, l’eau a mauvaise réputation. On la soupçonne de véhiculer miasmes et maladies, dont la peste. Pas tout à fait à tort. Les installations sanitaires sont insuffisantes, surtout dans les grandes villes - Paris est réputée pour sa puanteur - et plus encore à la cour.
Sous Louis XIV, le château de Versailles alla jusqu'à abriter 10 000 personnes, qui manquaient cruellement de latrines et de salles d’eau. Pour se nettoyer, on employait un linge, appelé "toilette", que l’on imbibait d’une "eau de toilette" (un peu d’étymologie au passage…). On changeait ses vêtements plusieurs fois par jour, on masquait les odeurs corporelles par des poudres odorantes et des parfums plus ou moins capiteux. Les peaux malades ou vérolées étaient dissimulées sous les fards contenant toujours la toxique céruse.
Mme de Pompadour, sublime favorite de Louis XV n'échappa pas à leurs effets délétères, comme en témoigne ce portrait qu'un contemporain** fit d'elle à l'âge de 36 ans : "Quelle décrépitude ! Quelle dégénération dans les formes ! Quelle saleté dans le visage ! Elle se plaît à s'ensevelir habituellement sous une couche de blanc et de rouge [...]".
Une révolution est en marche
Cette révolution-là ne vint pas du peuple mais de la reine elle-même. Avant d’arriver à Versailles, à l’âge de 14 ans, Marie-Antoinette avait grandi entre les palais de Vienne et de Schönbrunn : autant dire à la campagne. A la cour d’Autriche, l’étiquette était beaucoup moins "lourde" qu’à Versailles, les tenues plus simples, la nature plus proche. Cette enfance va influencer les goûts de Marie-Antoinette et, indirectement, la mode à la française.
En effet, à la cour de Louis XV, l’extravagance et le ridicule atteindront des sommets. Robes aux volumineux paniers, rubans et dentelles à foison, maquillages outrés, coiffures et perruques sophistiquées. A partir de 1770, celles-ci devinrent de plus en plus hautes et élaborées, allant jusqu’à s’orner d’objets ou d’animaux. Toutefois, de telles pièces montées ne furent jamais portées au quotidien mais seulement arborées par quelques happy few lors de happenings comme les fêtes à Versailles.
Même si elle est sensible à cette mode, Marie-Antoinette se prend de plus en plus pour une bergère dans son hameau fraîchement construit. En 1787, elle pause "en gaulle", c'est-à-dire en robe de fin coton et chapeau de paille. Le tableau n’est pas loin de créer le scandale, mais la mode est lancée : retour à plus de naturel. A la tubéreuse, la jonquille, l’œillet, le benjoin, prisés par Madame de Pompadour, Marie-Antoinette préfère la rose, la violette et le jasmin. Leur mode perdurera pendant plus d’un siècle.
À la cour, la reine met également fin à la mode des maquillages excessifs. Il est vrai que cette tendance coïncide avec les mises en garde des autorités médicales contre la céruse. On préfèrera dès lors les "toilettes de flore", préparations cosmétiques où les pigments minéraux sont remplacés par des extraits végétaux comme le safran ou le carthame. D’où ces teintes plus douces et plus naturelles sur les visages des coquettes, que les tableaux de Mme Vigée-Lebrun, Watteau ou Fragonard surent si bien nous transmettre.
- La recette "à la manière de" Pierre-Joseph Buc’hoz
Eau d’ange simplifiée : inspirée de la recette de l'eau d'ange figurant dans l'essai "Toilette de flore" (1771).
Dans un flacon, versez 20 ml d'hydrolat de rose, 20 ml d'hydrolat de fleur d'oranger, 20 ml d'hydrolat de mélisse. Dans un petit récipient, versez 1 cuillère à café de teinture de benjoin (en pharmacie) et ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle de citron zeste, 1 goutte de girofle, 1 goutte de cannelle. Mélangez avec le manche d'une cuillère à café. Versez le tout dans le flacon contenant les hydrolats. Refermez le flacon et agitez bien.
Employez comme démaquillant léger ou lotion tonique. Si vous avez la peau particulièrement sensible et réactive, n’ajoutez ni benjoin, ni huiles essentielles.
- La recette infernale de Marie Meurdrac : lard d’être belle
"Il faut prendre du lard de la gorge d’un porc mâle qui soit bien gras, deux livres. Coupez-le par morceaux, et le mettez dans la Cucurbite avec deux poignées d’avoine blanche bien nette, deux onces de semence de Baleine ; après distillez au Bain bouillant. Cette eau est excellente pour nourrir le teint des personnes maigres et pour ôter les marques et rougeurs de la petite vérole, et autres". C’est bon à savoir !
* Le célèbre agronome Olivier de Serres en a même donné une recette, dans Le Théâtre d’Agriculture et Mésnage des Champs (1600), mais celle-ci est extraite d'Arts et Métiers mécaniques de Jacques Lacombe (1789).
** Jean-Louis Soulavie, Mémoires historiques et anecdotes de la cour de France pendant la faveur de la marquise de Pompadour (1802).