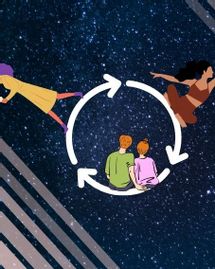“Je veux témoigner d’une incompréhension. Celle de voir des lits vides alors que ça déborde ailleurs. Je le dis sans colère, nous sommes un pays de privilégiés. Et au milieu de cette situation sans précédent, ce qui ressort c’est la raison pour laquelle on a choisi ce métier. C’est formidable d’aider son pays à sortir d’une telle crise sanitaire.”
Ce témoignage a été recueilli le 24 mars 2020.
Sa vie avant le Covid-19
Anne a 33 ans, elle est infirmière depuis 6 ans. A 17 ans, le bac en poche, elle enchaîne les petits boulots et par hasard commence à côtoyer le milieu médical. Elle sent que cette mission l’appelle. Après avoir passé son diplôme d’infirmière, elle quitte la région parisienne pour Toulouse, où elle vit actuellement en couple avec un enfant de 3 ans. Elle passe par de nombreux types de postes avant d’occuper sa fonction actuelle dans une clinique privée spécialisée en orthopédie. Dans sa vie normale, elle enchaîne les journées de 12h - de 7h30 à 20h15, avec une heure de pause repas, non recensée dans les 12 heures. Ce rythme, c’est 5 jours par semaine, et la semaine suivante, 2 ou 3 journées de 12h, “en fonction de la demande”.
Mais Anne ne se plaint pas, elle ne regrette rien. Elle aime son job, elle trouve son poste en service de soins vraiment intéressant. Pansements, perfusions, antibiotiques, antalgiques, rythment son quotidien. C’est son coeur de métier, elle en parle avec son coeur, même si déjà, elle souffre de ses conditions de travail. Elle sent que ses projets de vie sont limités par son salaire : 1600€ net par mois. Depuis deux mois, elle a arrêté de travailler les week-ends, rognant encore sa fiche de paye de quelques dizaines d’euros. Elle a aussi quitté le public, légèrement mieux payé, qui prolonge les CDD à l’infini, et offre des conditions de travail de plus en plus difficiles. L’an dernier, elle s’est portée volontaire pour couvrir le “plan hivernal”, celui des bronchiolites et autres gastro, et avoue n’avoir jamais connu des conditions aussi terribles d’accueil des patients. Une situation qui selon elle et ses collègues plus anciennes, remonte à au moins 5 ans.
Sa vie depuis le Covid-19
Pour Anne, tout a commencé par des discussions autour du café du matin. Nous sommes en décembre 2019. “Vous avez entendu parler du virus en Chine ?”. Après les vacances de Noël, il devient un thème journalier, et c’est “quand l’Italie est touchée, en février, qu’on commence à se dire que ça va arriver chez nous”. A ce moment précis, Anne remarque que ces bruits de couloirs n’atteignent pas la direction. “Le corps médical, les cadres de santé ne se sont pas sentis rapidement concernés”. “C’est comme une grippe” dit-on alors. On regarde les chiffres, on entend les témoignages venus des autres régions, des pays frontaliers, et “très longtemps, nous avons été rassurés au sujet du virus” explique Anne. “Personne ne l’a vu comme une menace grave”. Mais vers la mi-février 2020, des clans se forment. Il y a ceux, paniqués voire paranoïaques qui prennent la menace très au sérieux, et ceux, agacés, qui s’étonnent de la folie ambiante. Il se créé un énorme clivage d’opinion au sein même de l’établissement de santé.
Peu à peu, les patients commencent à s’inquiéter. Nombre d’entre eux ont des questions, des peurs, arrivent avec des masques… Et la clinique reçoit les premières directives de l’ARS (Agence Régionale de Santé ndlr) bien avant l’annonce du confinement généralisé. C’est là, début mars 2020, que les premières difficultés arrivent. Limiter le nombre d’accompagnants à un seul par chambre est très difficile à accepter pour les patients, notamment en pédiatrie où un seul parent est présent auprès de son enfant hospitalisé. “Les patients ne se sentent pas malades, et c’est d’ailleurs le gros souci avec ce virus, la plupart sont asymptomatiques”. Cela devient alors sérieux pour le personnel soignant, l’inquiétude gagne les rangs. “Nous sommes au bout de la chaîne”, explique Anne, “quand une directive de l’ARS arrive jusqu’à nous, c’est que c’est vraiment grave”. Faut-il porter des masques ? Y aura-t-il assez de stock ? A ce stade la direction de l’établissement reste rassurante, mais le personnel soignant se doute que la petite quantité dont est dotée chaque service ne suffira pas. “On a très vite vu arriver le problème de manque de matériel de protection”. Mais pour l’heure, peu de patients atteints du coronavirus sont accueillis dans l’établissement où exerce Anne, qui n’a pas de service d’urgence.
Sa vie depuis le confinement
En 48h, c’est le branle-bas de combat. Les services sont vidés, toutes les opérations programmées, annulées. Appeler les patients, un par un, leur expliquer. Regrouper ceux qui restent à la clinique, trop fragiles, au sein du même service. Faire de la place pour accueillir les patients Covid-19. Anne continue à travailler, mais nombre de ses collègues sont placés en congés, RTT ou chômage partiel. L’effectif passe d’environ 150 à 10, et il est désormais certain que les salaires seront rognés.
A présent une aile entière de la clinique est dédiée aux patients Covid, suivant la recommandation de l’ARS, qui indique que les établissements privés vont être réquisitionnés. Est ce qu’Anne souhaite être affectée à l’aile Covid ? Bien sûr. Une décision mûrement réfléchie et discutée en famille, qui s’accompagne d’un mélange de sentiments : passer de la crainte de transmettre le virus à sa famille, au devoir infirmier. Le pire pour elle ? Voir des témoignages de collègues quasi à l’agonie pendant que d’autres sont contraints d’adopter le chômage partiel. Une infirmière qui ne travaillerait pas en ce moment ? Très difficile à envisager pour Anne, dont la plus grande peur est finalement de ne pas participer à gérer cette crise sanitaire sans précédent. “Nous avons un rôle à jouer, et j’aurais très mal vécu de rester chez moi”.
Et Anne de conclure sur un constat clair “Il va être très long de sortir de tout cela. La vie normale, c’est pas pour tout de suite, et ce qui était notre quotidien ressemble désormais une vie rêvée”.