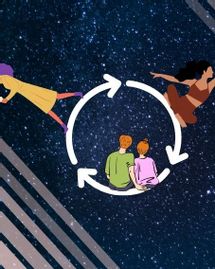Quand j’étais petite, nous vivions à Tahiti, pays de ma mère. Tahiti a 132 km de côte et le Mont 'Orohena domine à plus de 2 000 m d'altitude. Il fallait une journée pour faire le tour de l’île par la route de sable, contre deux heures aujourd’hui.
Quand j’étais petite, nous vivions à Tahiti, pays de ma mère. Tahiti a 132 km de côte et le Mont 'Orohena domine à plus de 2 000 m d'altitude. Il fallait une journée pour faire le tour de l’île par la route de sable, contre deux heures aujourd’hui.
Imaginez un sommet central qui se déploie vers la mer en vallées profondes creusées de rivières et de cascades. Les plages noires de sable volcanique très fin, ou blanches, roses, jaune d’or ou bleu nacré, selon ce que les millénaires avaient déposé sur un mètre de profondeur au bord des lagons turquoise. La Perle du Pacifique !
Peu se souviennent des plages colorées : des pelleteuses ont avalé ces pures merveilles pour les exporter vers la Métropole, la France qui, disaient nos livres d’école, ne nous voulait que du bien, à nous, les sauvages, qui naguère vivions nus. La loi interdisait le port du paréo en ville, à Papeete, au prétexte que nous étions nus sous le paréo, qui se portait du ras du cou aux chevilles !
Notre isolement se comptait en semaines de navigation de cargo : 5 à 6 semaines pour la France, 3 pour San Francisco ou la Nouvelle-Zélande, 12 à 15 jours pour la Nouvelle-Calédonie. Ce n’est qu’en 1961 que s’est ouvert l’aéroport de Tahiti. Face à l’océan, j’étais fascinée par le globe terrestre. Je rêvais d’être poisson ou oiseau, image parfaite des voiliers qui allaient marquer ma vie durant des dizaines d’années.
Tahiti, un plaisir pour les sens
L’île était imprégnée de l’odeur des fleurs, gardénias et tiaré le matin, et, la nuit, celle des ylangs-ylangs, qui descend des vallées avec le houpé, l’humidité fraîche du soir.
Quant aux couleurs, chaque archipel a des tonalités différentes, selon les heures et les saisons. Aujourd’hui encore, je distingue d’un coup d’œil une photo de bord de mer aux Antilles, en Polynésie ou aux Bahamas. Enfants, nous savions l’heure précise aux seules couleurs du paysage. À la saison chaude et humide, vers 17 heures, les feuilles de maïoré (arbre à pain) sont bleues. Les rayons très jaunes se mêlent au vert sombre de la feuille. C’est déjà le soir, car sous les tropiques, la nuit noire tombe brutalement à 18 heures sensiblement toute l’année.
À la saison sèche et fraîche, vers 10 heures du matin, le lagon turquoise tire plus sur le vert clair. La contemplation est fondamentale chez les Maoris ; ma grand-mère disait que toutes les réponses sont dans la nature.
Et n’oublions pas les sons ! Peut-être imaginez-vous nos îles calmes, silencieuses, ne serait-ce que la nuit. Il n’en est rien ! Les seuls moments vraiment silencieux sont les veilles de très grosses tempêtes ou de cyclones. Jour et nuit, le fracas des vagues de haute mer sur le récif des lagons peut faire trembler les maisons comme le métro à Paris ! Les oiseaux sont très bruyants aux lever et coucher du soleil. Les coqs chantent à toute heure, les chiens et les chats se disputent. Comme sur un voilier, le silence et le calme sont rares.
L’art polynésien de la cuisine
La cuisine traditionnelle est essentiellement crue, car le four tahitien est toute une aventure. On prend un grand trou dans le sol, garni de pierres volcaniques. On brûle du bois jusqu’aux pierres rouges. On pose alors fruit à pain, patates douces, taro, fé’i, poulet, poisson, coquillages, cochon de lait, soigneusement enveloppés dans des feuilles fraîches de diverses essences. On recouvre le tout d’une belle épaisseur de feuilles de bananier. Et on laisse cuire pendant 6 à 8 heures à la chaleur des pierres. Impossible à faire trois fois par jour ! Jamais je n’ai retrouvé ailleurs la peau croquante du cochon de lait, le fruit à pain qui, mûr, est comme un gâteau au caramel, le poisson que l’on s’est bien gardé de vider… Je m’en régale en l’écrivant.
On appréciait donc poissons ou coquillages marinés dans du jus de citron, assaisonnés de lait de coco fraîchement râpé et pressé, ou fermenté dans une calebasse avec du citron et une crevette, ce qui donnait une sorte de yaourt, le miti hué, exquis... Notre boisson sublime était l’eau du coco vert, un bonheur qui ne m’a jamais quittée !
Et n’oublions pas le repas de fruits quotidien ! La mangue que l’on vient de cueillir, dont le jus dégouline le long des joues, la goyave rose dont le parfum porte à plusieurs mètres, les bananes, le kava, l’ananas, la pomme étoile, le corossol, la grenade cueillie sauvage au fond de la vallée, l’orange à peau verte, les tamarins, tous ces fruits accompagnés de lait de coco fraîchement pressé et de jus de citron... On comprend aisément d’où vient mon inspiration pour la création du Miam-Ô-Fruit !
Une manière d’être
Mon enfance a aussi été marquée par le sens de la beauté naturelle qui ne se traduit ni par le maquillage, ni par le vêtement, mais par une gestuelle, une grâce innée, un sourire, un regard, la manière de donner ou de prendre un objet, de se baisser ou de se relever. Sans oublier la démarche souple et gracieuse, pieds nus, les hommes comme les femmes, le regard confiant de qui n’a jamais connu ni l’esclavage, ni la soumission. Regard franc et doux à la fois, sans arrogance ni prétention. Une grâce partagée, tout comme la force physique, par les hommes et les femmes, dans une civilisation où les prénoms sont mixtes, où filles et garçons étaient élevés exactement de la même manière, sans clivage des sexes, ce qui plaisait beaucoup au Dr Françoise Dolto, comme elle le raconte dans La Cause des adolescents.
On ne peut dissocier cette beauté de la philosophie des Maoris, le aïta pe’a pe’a. Si certains Européens y voient une insouciance qu’ils méprisent ou envient, il m’est bien difficile de décrire cette formidable capacité au bonheur, cette extraordinaire disposition à être heureux quoi qu’il advienne, deuil, perte de tous ses biens par le feu ou à cause d’un cyclone, et même prison. L’opposé de ceux qui se plaignent toujours et sans cesse. Attention, je parle là de ce qui était le cas jusque vers 1968 ! Du temps où, par contrat de donation à la France en 1848, toutes les terres n’appartenaient qu’à ceux qui avaient du sang maori.
Pas de bidonvilles, pas de mendiants ni de clochards. Tout le monde avait de quoi se loger et se nourrir, c’était le temps de l’indivision, chaque famille habitait une vallée. Entre ceux qui quittaient l’île pour découvrir le monde et une natalité très raisonnable, la population ne manquait pas de ce qui permet à chacun de vivre. On pouvait toujours vendre le produit de sa pêche ou de sa cueillette pour acheter un peu de tissu.
Toutes ces particularités ont profondément marqué toute ma vie. Cette capacité au bonheur existe encore, mais la télévision et les marchands de toutes sortes d’inutilités alimentaires l’ont détériorée depuis plus de cinquante ans. Un retour aux premières valeurs se dessine, il reste encore des mailles auxquelles se raccrocher et qui ne demandent qu’à être multipliées. Saisissons cette chance !