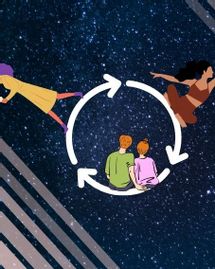Nous sommes nées dans les années 1980, nous avons connu, de loin, le minitel rose, les films érotiques de M6, les magazines pornos que l’on exhume froissés de leurs cachettes, les sex‐shops aux enseignes lumineuses dont l’accès nous étaient interdits. On nous a dit qu’il fallait maîtriser le sujet, mais aussi ne rien en connaître. À cela s’est ajouté l’effet cumulatif des légendes urbaines, élucubrations, fantasmes débridés et autres tâtonnements empiriques, ainsi que l’installation suivie de la désinstallation de diverses applications mobiles destinées à mettre en relation les individus. Et puis, l’actualité sexuelle s’est imposée à nous : depuis octobre 2017, le mouvement #MeToo de dénonciation des violences sexuelles a également eu pour effet d’accélérer une conquête du plaisir féminin, notamment sur Internet.
Des charges mentale et émotionnelle
La même année, la dessinatrice Emma nommait, dans les trois tomes de sa bande dessinée Un autre regard, ce travail invisible qui constitue l’un des fondamentaux de la condition féminine : la charge mentale. Une incessante mécanique cognitive. En d’autres mots, les femmes sont les gestionnaires du foyer. Elles pensent, organisent, anticipent. Dans la foulée, la bédéiste a fait émerger une autre composante de la domination masculine : le travail émotionnel, qui désigne le souci constant des autres. Cette charge émotionnelle, de toute évidence, est comme la charge mentale : invisible et essentiellement féminine. L’arrivée providentielle de #MeToo et cette redécouverte des charges mentale et émotionnelle se sont combinées dans nos esprits : un sujet naissait. Fruit de ces réflexions, en février 2019, l’une des coautrices de ce livre publiait alors sur le site Slate.fr un article intitulé « Désir, plaisir, contraception, MST... c’est la charge sexuelle ». Il décrivait la manière dont ces concepts se déclinent dans l’intimité, sous forme d’un labeur parfois pénible, invisibilisé et non rémunéré. Car s’il est acquis que la vie érotique entraîne dans son sillage un spectre d’expériences allant de la légèreté au trouble en passant par l’extase et l’indifférence, on parle moins de sa pénibilité.
>> A lire sur FemininBio Emancipation féminine : le Womenpowerment vu selon le mythe d'Icare
Un labeur sexuel invisible
En effet, il peut paraître contre‐intuitif, voire dérangeant, de penser au sexe comme à un labeur. Nous mettons volontairement de côté le vécu très spécifique des travailleur.se.s du sexe, qui a fait l’objet d’enquêtes ailleurs et n’est, d’ailleurs, pas dépourvu d’injonctions et de stéréotypes (putophobie...). Alors, peut‐être avez‐vous ouvert cet ouvrage, convaincu.e : la charge sexuelle vous évoque immédiatement souvenirs amers et anecdotes cuisantes. Peut‐être, à l’inverse, la charge sexuelle n’a‐t‐ elle rien d’évident à vos yeux. Il y a une raison à cela : c’est précisément tout le principe du travail invisible, que de passer inaperçu. Il est non seulement indétecté par ses bénéficiaires, mais y compris par les travailleur. se.s eux.elles‐mêmes. Nous n’en avons pas forcément conscience avant de l’accomplir. De manière concrète, ce labeur sexuel invisible comprend, par exemple, le fait de s’apprêter pour plaire, de s’inquiéter du désir d’autrui, de son plaisir ou encore de se renseigner au sujet d’une vie sexuelle digne de ce nom. De façon plus abstraite, c’est aussi la pression pour les femmes de se conformer à des normes sexuelles : être hétéro, d’abord, mais aussi avoir de l’expérience, mais pas trop de partenaires, pour maintenir sa respectabilité. Posséder un gode, mais que celui‐ci ne concurrence pas le pénis du conjoint – si conjoint il y a. Le discours sur la sexualité reste le lieu par excellence de l’ambivalence. Des injonctions contradictoires et des contraintes qui parasitent le désir féminin, paralysent la volonté et entretiennent sur le corps féminin une forme de contrôle et d’autosurveillance.
Le monopole de la puissance masculine
Pour concevoir la charge sexuelle, il faut au préalable reconnaître la domination masculine et les privilèges objectifs dont on jouit lorsqu’on est un homme. C’est‐à‐ dire l’androcentrisme de la société : tout tourne autour, tout est fait pour, tout est à l’image du masculin. Cela veut dire admettre une certaine hypertrophie de la sexualité masculine, reflétée par une hypervisibilité des organes sexuels, des sex‐shops qui poussent partout et entre deux restaurants, des publicités équivoques, une multiplication de sites pornographiques accessibles et des unes de magazines... Bref, l’offre est pléthorique. Et dans ce vaste open bar sexuel, les hommes hétérosexuels jouiraient du monopole de la sexualité. Or, précisément, il nous semble que cette hégémonie n’existerait pas sans le labeur invisible des femmes. Alors pourquoi le monopole de la puissance sexuelle serait‐il masculin quand ce sont les femmes qui font une majorité du travail ? La charge sexuelle incarne en effet ce paradoxe : d’un côté, une visibilité masculine dans le discours et l’espace public, et dans l’ombre, un effort féminin peu reconnu, voire nié, délégitimé, ou moqué. Dans certains cas, l’inégalité saute aux yeux : il n’y a qu’à voir les doubles standards de la virginité, du slutshaming, de la contraception, de la lingerie, des nudes, du revenge porn, sans parler des violences sexuelles... qui pèsent quasi exclusivement sur la sexualité des femmes. D’autres cas de charge sexuelle sont plus insidieux, plus difficiles à détecter : la transmission du savoir sexuel, le soin de soi ou le souci permanent de l’autre.
 Ce préambule est extrait du livre La charge sexuelle de Clémentine Gallot et Caroline Michel, publié aux Editions First.
Ce préambule est extrait du livre La charge sexuelle de Clémentine Gallot et Caroline Michel, publié aux Editions First.